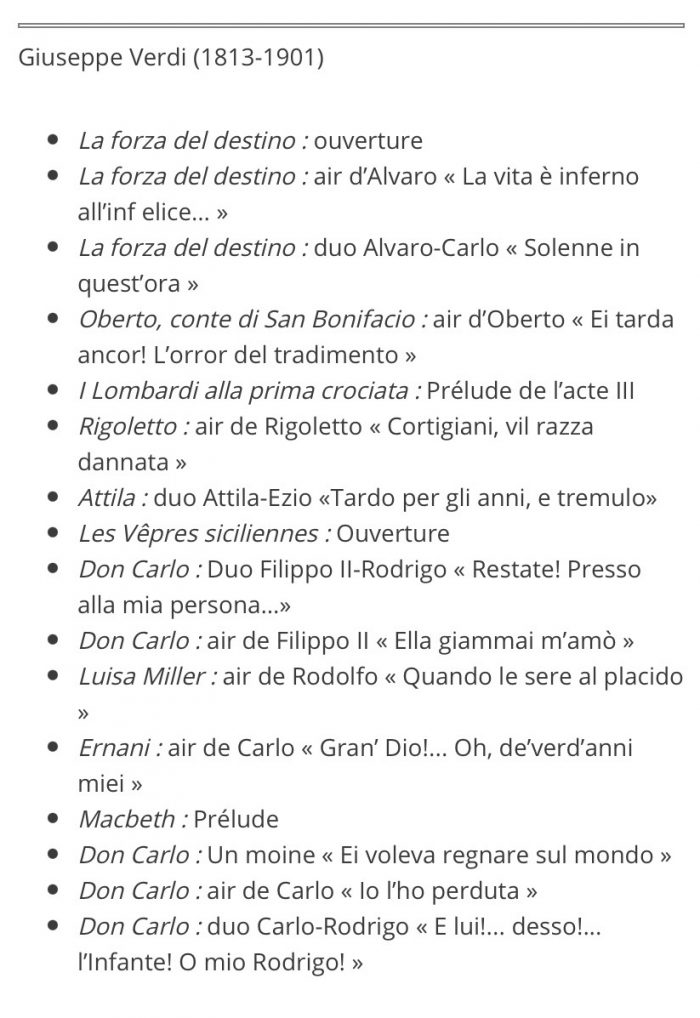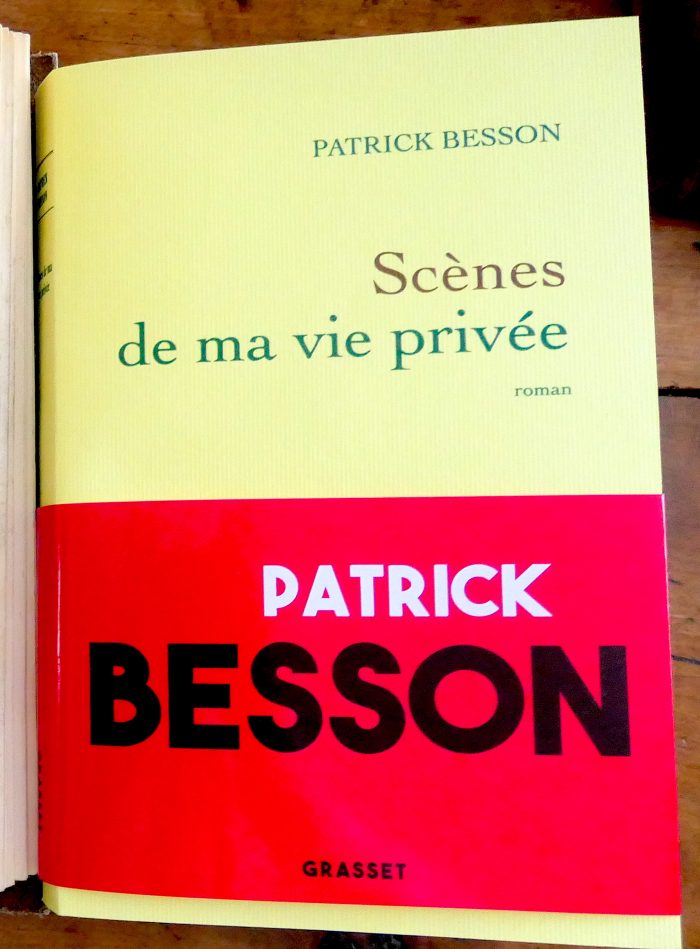C’est avec une voix off, très rare à l’opéra, que commence « Cavalleria Rusticana » de Mascagni. Le public cherche des yeux le ténor caché derrière le décor, et lui il chante sans être devant son public, double solitude qu’on retrouve à la fin puisque Turridu meurt en coulisses alors qu’une voix sans visage annonce sa mort.
Ce chant, huit vers écrits en sicilien, a donné le nom de Sicilienne à l’air « O Lola » où Turridu célèbre la beauté de sa maîtresse certain qu’il se croirait encore au paradis s’il répandait son sang devant sa porte. Or, si rien n’est plus fort qu’une déclaration qu’on fait à l’autre en sa présence, rien n’est plus pathétique que des aveux adressés à l’absent (e), la non réponse autorisant à tout supposer.

Des sentiments de Lola, que sait-on ? Mais rien !
Sans elle, pas d’histoire, pourtant son rôle, le moteur de la nouvelle de Verga, est secondaire. Elle n’existe qu’à travers les sentiments des autres : l’amour de Turridu, la jalousie de Santuzza, la vengeance de compar’ Alfio, mais jamais davantage que dans cette voix off qui nous vient des coulisses, cette voix, pas encore incarnée puisque Roberto Alagna est invisible, mais dont la suavité céleste écarquille nos yeux et nos
Cette voix, dont on peut avouer à quel point l’ampleur des aigus, la puissance du medium, le legato idéal et la diction parfaite demeurent insaisissables avec des mots devenus creux, elle est pluie de pétales dans un jardin japonais, danse de la lune sur les vagues de la mer, coulée d’or dans le creuset des alchimistes, resplendissement du soleil drapé de noir, de pourpre et d’or qui vous force à fermer les yeux comme, ce soir, elle vous ouvre le cœur.

La Sicilienne contient tout l’opéra, elle en est la matrice et le germe fécond.
Le mystère des mots s’y ajoute à celui de la voix et, lorsque Turridu fait son entrée, le personnage passe de son rêve d’amour à une réalité cruelle -, qui va le détruire, alors que le public, déjà introduit dans la poésie lyrique par ce timbre unique, d’une musicalité angélique, voit son rêve incarné en un Roberto Alagna radieux-, qui va transporter l’Arena .
Pour Turridu, la réalité c’est Santuzza qui s’accroche à lui, réclame, pleure, exige alors qu’il lui donne tout ce qu’il peut donner, il est son amant, pas tout à fait à son corps défendant, mais parce que la Lola de son rêve, celle de la Sicilienne chantée en coulisses pour qui il est prêt à verser son sang (et il va le verser), Lola, celle de la réalité, celle qui trahit, en a épousé un autre, le riche charretier Alfio. Il serait trop facile d’accabler Lola. Dans la Sicile traditionnelle décrite par les décors et les costumes, elle a dû être l’objet de pressions insupportables auxquelles elle a cédé, elle est faible, elle l’a prouvé en étant infidèle à son fiancé et en lui revenant, elle trompe tout le monde, mais est-ce si simple? La partition lui donne peu à chanter mais des airs qui ne correspondent pas à un caractère de coquette et au contraire montrent une jeune fille qu’on a poussé à épouser un autre que son promis et qui revient vers lui, toujours éprise, bien que mariée. Exactement comme le Turridu que révèle Alagna, irrésistiblement attiré par Lola, bien que lié à Santuzza et décidé à l’épouser. Alagna a dans le regard la déchirure de Turridu qui hésite entre les deux femmes, entre les deux choix, la sagesse ou la folie, le risque ou la sécurité lorsque le duo devient trio et la situation inextricable. Il ne montre aucune exaspération contre Santuzza chez Turridu, il est sensible à son amour même de ventouse, ne veut pas qu’elle souffre, sait qu’elle souffre à cause de lui, mais rompre avec Lola, il ne peut pas.

Sait-il que Santuzza, après avoir essayé de le protéger en empêchant Mamma Lucia de dire à Alfio où était son fils, elle l’a livré ? Qu’il le sache ou non ne change rien. Dans ces villages tout se sait. Si Santuzza n’avait pas parlé, un jour ou l’autre Alfio aurait appris l’adultère de sa femme et le nom de l’amant, ce nom que Canio va réclamer à Nedda avec fureur dans Pagliacci.
Alors on entre dans cette chevalerie rusticana où un affront fait à l’honneur doit être vengé dans le sang.
Turridu mord l’oreille de compar’Alfio, c’est lui qui provoque, or il n’est pas l’offensé, il est l’offenseur, il le reconnait lui-même. Mais il est aussi l’offensé puisqu’Alfio a refusé de boire avec lui, après le brindisi étourdissant où ni Turridu ni Lola n’ont montré la moindre prudence ; demander à l’homme dont on a séduit la femme de boire ensemble, c’est de la provocation ; ainsi les complications de la chevalerie campagnarde n’ont rien à envier à celles qui opposent les duellistes de la noblesse. Turridu va se battre pour gagner, pour tuer, il le dit à son adversaire, sinon Santuzza sera abandonné, mise au ban du village, rejetée par tous, une paria, une pestiférée qui s’est donnée sans avoir au doigt la bague recommandée par Méphisto.

L’opéra se termine par les adieux à sa mère, Mamma Lucia, que Roberto Alagna rend bouleversants.
Il ne sait pas qu’Alfio va lui jeter du sable dans les yeux, pour l’assassiner au lieu de se battre contre lui, mais tout en lui le pressent : la demande de la bénédiction comme avant de partir à l’armée, les recommandations qu’il lui fait de servir de mère à Santuzza, s’il ne revenait pas, le mensonge d’enfant lorsqu’elle s’ inquiète et qu’il répond qu’il a abusé du vin pétillant et enfin son départ comme une fuite.
Il court mourir dans les coulisses d’où il émergeait radieux après la Sicilienne. On ne le verra plus. Alafio l’a assassiné le jour de Pâques. Il est mort le jour de la Résurrection.
On ne le verra plus ce soir, mais après l’entracte le Canio de Roberto va enchanter l’Arena.

©Jacqueline Dauxois